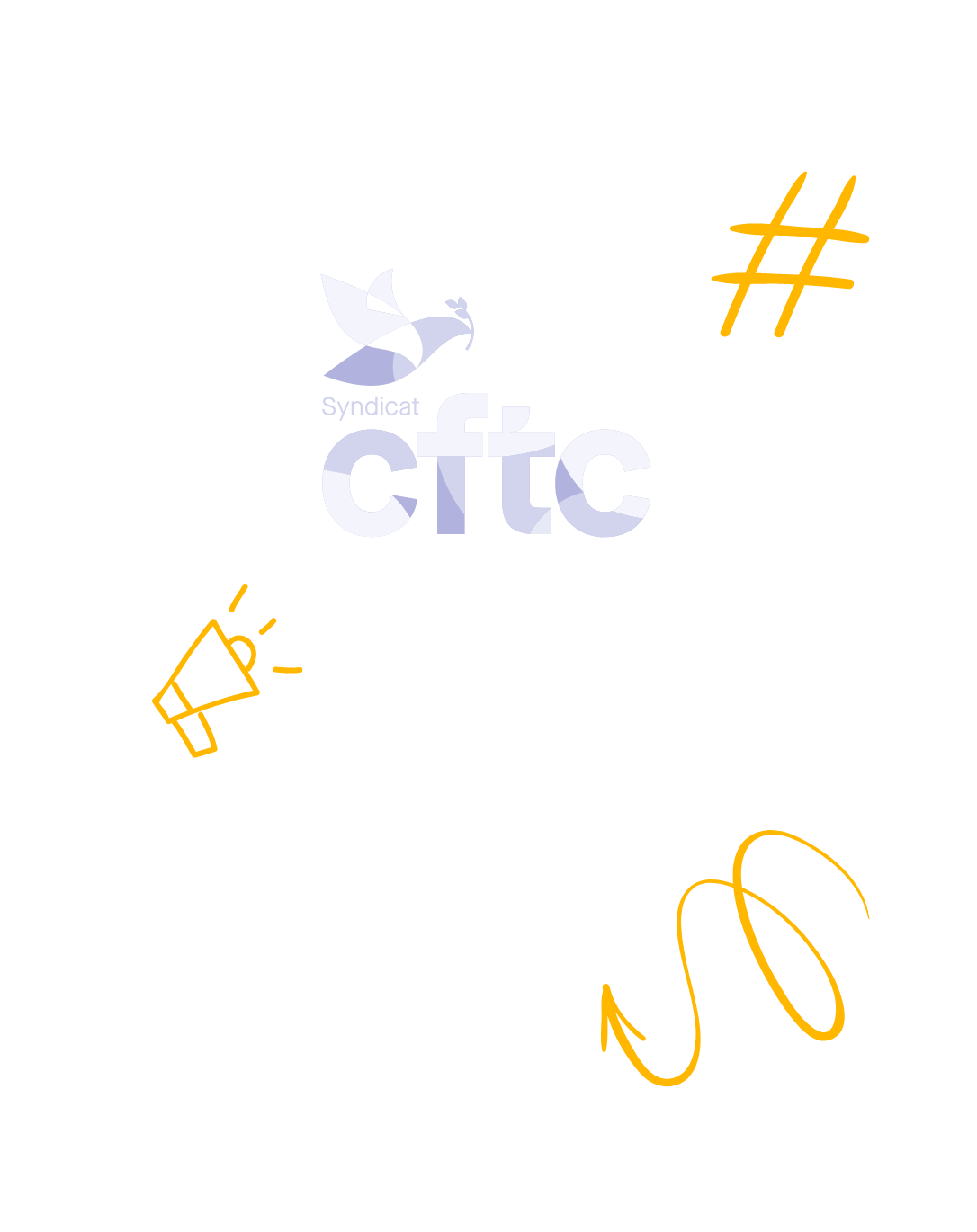Pesticides, évaluation des risques sanitaires : quel bilan faire de la loi Duplomb?
28 août 2025 | SantéSocial
Feuilleton médiatique et politique de l’été 2025, la loi dite « Duplomb » a finalement été promulguée par Emmanuel Macron mi-août. Censuré par le Conseil Constitutionnel, le texte a cependant été amputé de l’une de ses mesures phares, qui prévoyait la réintroduction d’un pesticide controversé, l’acétamipride. Cette substance avait pourtant eu l’aval de l’Anses – un organisme public d’évaluation des risques sanitaires – au sein duquel la CFTC dénonce depuis des années les ingérences croissantes de l’Etat. Explications avec Pierre-Yves Montéléon, représentant de la CFTC à l’Anses et actuel président du Conseil d’administration de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).


© Hervé Boutet pour l’INRS/2025
Pierre-Yves, après plusieurs semaines de controverses et de débats, la loi Duplomb a été censurée par le Conseil Constitutionnel de sa mesure la plus contestée. Celle-ci visait à autoriser l’usage d’un pesticide, l’acétamipride. Que retenez-vous de cette séquence politique et médiatique ?
C’est assez ambivalent à évaluer. D’une part, on sait que des travailleurs sont exposés – la population aussi – à la toxicité de ce pesticide, avec les dangers potentiels qui en découlent. D’autre part, les agriculteurs nous expliquent qu’ils sont en concurrence avec des professionnels qui utilisent ce produit à l’étranger et que, sans cette substance, des emplois seront perdus. A cet égard, il faut relever que la France avait d’abord décidé de bannir en 2018 tous les néonicotinoïdes, la famille de pesticides à laquelle appartient l’acétamipride. Avant sa censure, l’une des mesures de la loi Duplomb visait donc à revenir sur cette décision, sous prétexte que ce pesticide est autorisé dans 26 des 27 pays de l’Union Européenne.
Il y a donc eu un arbitrage à faire, entre les enjeux sanitaires et les enjeux économiques. Ceci étant dit, à l’origine, l’Anses a été crée comme une agence d’évaluation des risques sanitaires. Le cas échéant, l’acétemipride est un produit qui pollue. Il met à la fois en danger l’environnement et la santé humaine, en premier lieu celle des agriculteurs d’ailleurs.
L’Anses a pourtant rendu plusieurs avis sur le sujet. Aucun n’a interdit formellement l’usage de l’acétemipride pour certaines cultures spécifiques, notamment celle des betteraves sucrières.
C’est exact. Ce qui nous interroge ici à la CFTC, c’est précisément le mode de gouvernance de l’Anses, qui peut partiellement orienter certaines de ses prises de décision. Je m’explique: initialement, l’Anses était supposée être une autorité indépendante d’évaluation des risques sanitaires. Néanmoins, elle ne prenait pas la décision d’interdire tel ou tel produit, c’était au Ministère de l’Agriculture de le faire, sur la base des avis de l’Anses (qu’il pouvait suivre ou pas.)
Sous la présidence de François Hollande, l’Etat a transféré directement à l’Anses ce pouvoir d’interdiction ou d’autorisation. Les avis de l’Anses se basent certes toujours sur des études scientifiques menées par des chercheurs indépendants, mais cette évolution du mode de gouvernance a quand même changé pas mal de choses.
C’est à dire ?
Pour faire court, il a été choisi de ne plus séparer le scientifique de la décision politique. Cette double compétence a mis l’Anses en première ligne des critiques, notamment des agriculteurs, renforçant ainsi les pressions exercées sur l’agence. Ensuite, depuis quelques années, l’Anses doit aussi intégrer un volet socio-économique à ses avis. Cette composante socio-économique quantifie les impacts – notamment sur l’emploi – que pourrait avoir l’autorisation ou l’interdiction des produits qu’elle évalue.
Tout cela participe à mettre l’Anses en situation de conflit d’intérêt permanent : on mesure la dangerosité sanitaire d’un produit mais on autorise ou pas son utilisation sur la base de critères qui ne sont plus exclusivement sanitaires, mais aussi économiques. Au passage, rappelons que le directeur général de l’Anses est nommé par l’Etat, qui, dans ces dossiers, doit composer avec des enjeux et pressions qui ne sont pas du seul domaine de la santé.
La CFTC est représentée au Conseil d’administration de l’Anses. A-t-elle pu soulever les problèmes que vous pointiez plus haut ?
Bien sûr. La CFTC a toujours milité pour que l’Anses reste exclusivement une agence d’évaluation des risques sanitaires, afin que l’Etat assume seul, en bout de chaine, la prise de décision. Nous avons saisi le comité d’éthique à ce sujet, mais nous n’avons jamais obtenu gain de cause.
Le jour du vote de la loi Duplomb à l’Assemblée Nationale, un décret a été publié en parallèle: il stipule que l’Anses devra désormais prendre en compte les priorités du ministère de l’Agriculture pour établir « le calendrier d’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. » Comment interpréter ce changement ?
En résumé, cette mesure force l’Anses à considérer les priorités du ministère de l’agriculture, lorsqu’elle établira son calendrier d’examen des autorisations de mise sur le marché. L’agence risque donc de perdre encore davantage en autonomie, vis-à-vis de l’Etat.
Fin mars 2024, vous avez aussi pris la présidence de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), un organisme public dont la mission est de développer et de promouvoir une culture de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’INRS travaille-t-elle aussi à évaluer les risques liés aux pesticides ?
Absolument. L’INRS participe à l’évaluation de la toxicité des produits auxquels les travailleurs sont exposés dans leur vie professionnelle. A titre d’exemple, l’INRS va d’abord rechercher à remplacer un produit ou un procédé dangereux par un autre qui ne l’est pas. Si ce n’est pas possible, l’INRS préconisera les protections et protocoles qui vont permettre de limiter au maximum l’exposition des salariés à ces produits, substances ou procédés.
Pour finir, en juin 2024, l’INRS avait alerté sur les réductions budgétaires qui lui sont imposés. L’Anses est-elle confrontée à des problématiques similaires ?
La politique de rigueur budgétaire – que le budget 2026 devrait poursuivre et accentuer – n’épargne en effet personne. Les contraintes financières sont donc aussi fortes sur l’Anses. A titre d’exemple, l’INRS ne peut plus produire autant d’études et de connaissances sur certains sujets. Tout cela est contraire aux recommandations de la CFTC et des partenaires sociaux : moins de régulation et de prévention contribue à mettre davantage en danger la santé des travailleurs.
AC