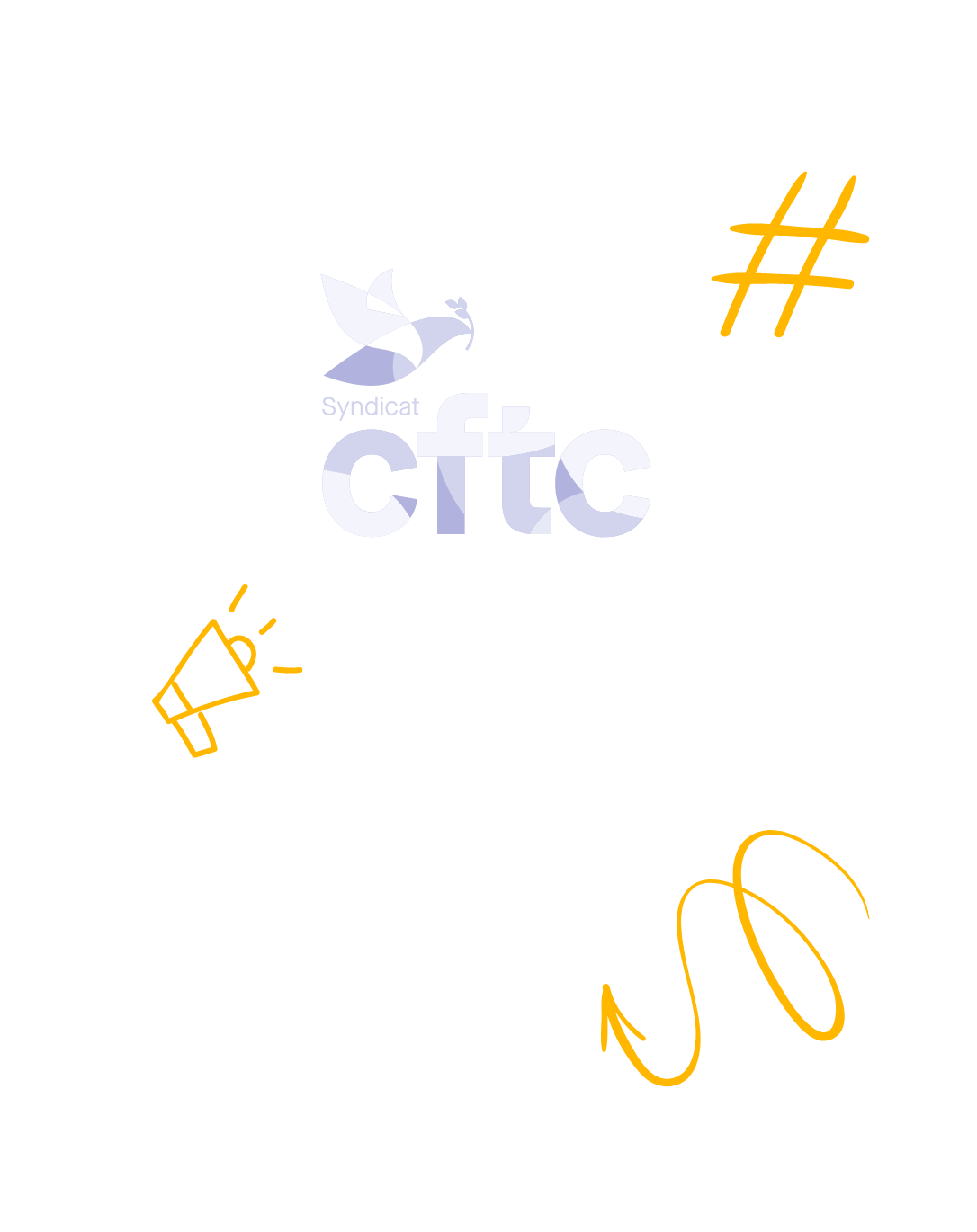Accords de performance collective : un progrès à signaler, mais un dispositif toujours trop permissif
7 octobre 2025 | Social
Crées par les ordonnances Macron de 2017, les accords de performance collective (APC) permettent, par la négociation, de modifier le salaire, le temps de travail et la mobilité, au nom de la préservation de l’emploi. Après la conclusion d’un tel accord, un salarié qui refusait la modification de son contrat de travail pouvait cependant se faire licencier. Un récent arrêt de la cour de la cassation change la donne : désormais, si un juge estime que les nécessités de fonctionnement de l’entreprise étaient insuffisantes pour justifier la mise en œuvre d’un APC, un salarié pourra toucher des dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif controversé de maintien en emploi, les accords de performance collective (APC) avaient été introduits en 2017 par les ordonnances Macron. Ils permettent à une entreprise en grande difficulté économique de modifier à la baisse les salaires ou encore de moduler le temps de travail de ses salariés, en vue de préserver au maximum l’emploi des travailleurs concernés. Si ces mesures se traduisent par un renoncement de certains droits et avantages pour les salariés, elles sont donc en contrepartie censées aider l’entreprise à éviter un éventuel dépôt de bilan ou une restructuration drastique de ses moyens et effectifs. Un accord de performance collective doit cependant préalablement être signé par les syndicats majoritaires (ou approuvés par référendum des salariés) pour être mis en œuvre.
Juger du bien-fondé de l’APC
Néanmoins, il arrivait parfois qu’un salarié refuse la modification du contrat de travail induite par un APC: le cas échéant, l’employeur pouvait licencier le salarié concerné pour ce motif spécifique, pour cause réelle et sérieuse. Si un APC avait été préalablement conclu, un salarié ne pouvait donc pas contester le bien-fondé de ce type d’accord.
Cependant, suite à un arrêt de la cour de cassation daté du 10 septembre, les salariés se voient désormais offert la possibilité de contester les motifs ayant justifié la mise en œuvre d’un APC. Si un salarié conteste juridiquement son licenciement, le juge devra ainsi examiner et déterminer si la signature d’un accord de performance collective était bien justifiée par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. S’il estime que ce n’est pas le cas, le salarié pourra donc toucher des indemnités en dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un dispositif encore trop permissif
La CFTC ne peut que saluer cette décision de la Cour de cassation. Pour notre organisation, cet arrêt de la Cour atteste par ailleurs du cadre réglementaire trop flou et permissif, qui régit l’application des APC. Une insuffisance dénoncée à plusieurs reprises par notre organisation. Si un APC doit en effet « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi », aucun critère objectif ne permet, en réalité, de matérialiser objectivement ces nécessités. A cet égard, la CFTC estime donc que ce cadre réglementaire doit être significativement précisé et renforcé, pour éviter d’éventuels abus et dérives, quant à l’utilisation de ce dispositif.
Le nombre d’APC signés chaque année reste heureusement faible, les salariés et leurs représentants n’acceptant que très rarement cette modalité de maintien en emploi. A ce titre, la CFTC rappelle qu’elle considère qu’un APC ne peut être envisagé que quand la pérennité de l’entreprise est sérieusement en cause. En dehors de ce cas de figure exceptionnel, l’entreprise peut déjà recourir à de nombreux autres dispositifs (chômage partiel, plan de sauvegarde de l’emploi, ruptures conventionnelles collectives etc…), davantage protecteurs des salariés et de leur contrat de travail.
AC